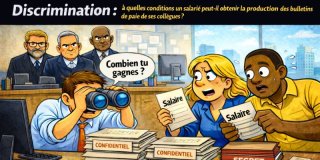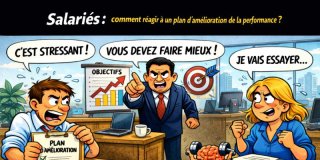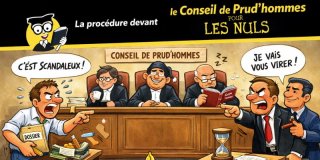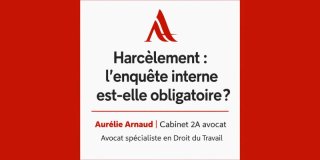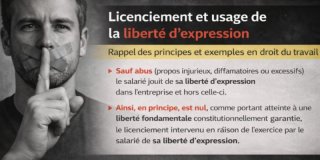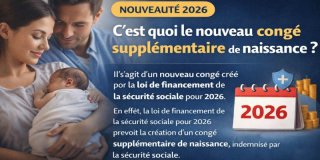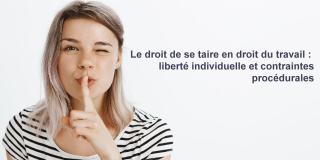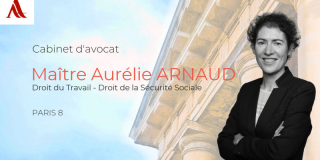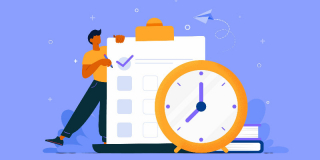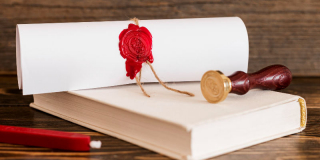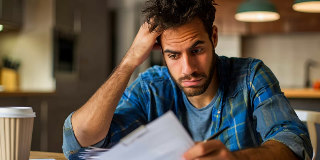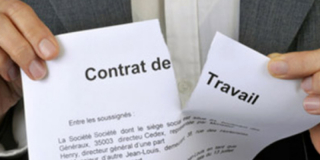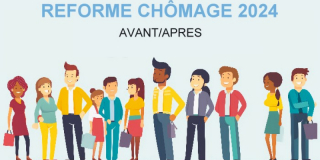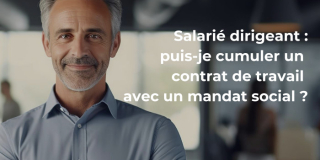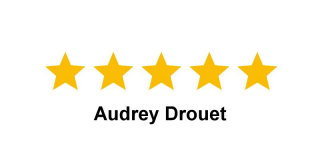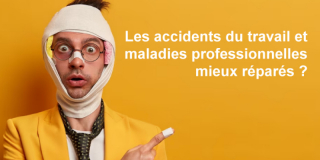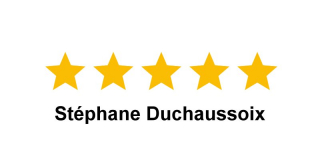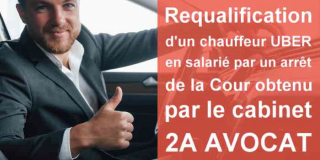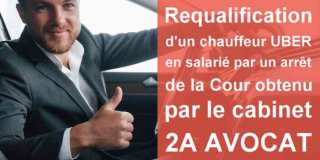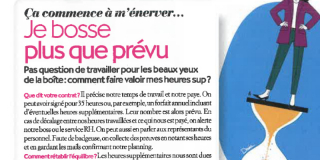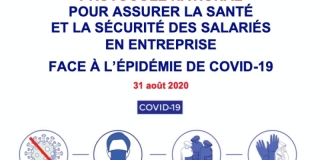Le calcul et la réclamation des heures supplémentaires par un salarié sont encadrés par des règles précises du Code du travail, de la Convention collective ou d'un accord d'entreprise et par la jurisprudence.
Voici les étapes et les éléments essentiels à prendre en compte. Cela ne concerne pas les salariés au forfait jours.
1. Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies comme les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein.
Cette durée peut être adaptée dans certains cas, notamment pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalence ou à une annualisation du temps de travail (pour ceux dont la durée est annualisée, les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 1 607 heures en général, sauf dispositions conventionnelles autres).
2. Calcul des heures supplémentaires
a. Taux de majoration
À défaut d'accord collectif, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée à :
- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure incluse).
- 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).
Les heures supplémentaires s'apprécient sur la semaine civile, du lundi au dimanche.
b. Base de calcul
La rémunération des heures supplémentaires doit être calculée sur la base du salaire horaire effectif.
c. Contingent annuel
Les heures supplémentaires sont limitées par un contingent annuel fixé à 220 heures par salarié et par an, sauf disposition différente prévue par un accord collectif.
3. Réclamation des heures supplémentaires
a. Délai de prescription
Le salarié dispose d’un délai de 3 ans pour réclamer le paiement des heures supplémentaires, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
b. Preuve des heures supplémentaires
La preuve des heures supplémentaires repose sur un régime de preuve partagée :
Le salarié doit présenter des éléments précis comme des plannings, tableaux de décompte, courriels, attestations.
L’employeur doit répondre en produisant ses propres éléments.
c. Saisine du Conseil de prud’hommes
En cas de litige, le salarié peut saisir le Conseil de prud’hommes compétent pour obtenir le paiement des heures supplémentaires. Le juge appréciera les éléments de preuve apportés par les deux parties et pourra ordonner des mesures d’instruction si nécessaire. Seule la saisine prud'homale arrête de faire courir la prescription de 3 ans.
4. Contrepartie obligatoire en repos
Lorsque le nombre d’heures supplémentaires dépasse le contingent annuel, le salarié peut bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos, sauf disposition contraire prévue par un accord collectif. Si le salarié n'en a pas bénéficié, il peut réclamer une indemnité à ce titre.
5. Résumé des étapes pour le salarié
| Étape | Détail |
|---|---|
| 1. Identifier les heures supplémentaires | Calculer les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou du contingent annuel pour chaque semaine civile travaillée. |
| 2. Vérifier les taux de majoration | Appliquer les taux de 25 % ou 50 %, sauf disposition différente prévue par un accord collectif. |
| 3. Réunir des preuves | Collecter des éléments précis : tableaux de décompte corroborés par des plannings, courriels, attestations, etc |
| 4. Respecter le délai de prescription | Introduire une action dans un délai de 3 ans à compter de la connaissance des faits. |
| 5. Saisir le Conseil de prud’hommes | En cas de litige, présenter les preuves au juge pour obtenir le paiement des heures dues. |